 Marianne, no. 652 - Magazine, samedi, 31 octobre 2009, p. 64
Marianne, no. 652 - Magazine, samedi, 31 octobre 2009, p. 64Le livre noir du patronat
Derrière leur façade respectable, nos grands dirigeants s'adonnent toujours, malgré la crise, à leurs travers : la collusion avec le monde politique et le trafic d'influence. C'est ce que révèle une enquête explosive dont "Marianne" publie les extraits.
C'est un pavé, une somme, presque une bible. Plus de 700 pages pour raconter l'histoire du capitalisme français, du compromis social de 1945 à "l'ère des tueurs", celle de ces patrons des années 2000, adeptes du toujours plus de fric et du toujours moins de règles. Sept cents pages pour dresser le portrait du patronat tricolore, des Trente Glorieuses à la crise financière de septembre 2008, ses méthodes, ses réseaux, ses lobbies, sa consanguinité aussi et, bien sûr, ses dérives et ses excès.
Histoire secrète du patronat : le vrai visage du capitalisme français* : ce livre, dont le titre sonne comme une urgence, s'ouvre sur une phrase d'Alain Minc, l'homme qui a tant vanté l'économie dérégulée. Le 23 mars dernier, dans le Figaro, il lançait cet avertissement, inattendu de sa part, à ses "amis de la classe dirigeante" : "Mesurez-vous que le pays a les nerfs à fleur de peau, que les citoyens ont le sentiment, fût-il erroné, de subir une crise dont nous sommes tous à leurs yeux les fautifs ? [...] Sentez-vous le grondement populiste, la rancœur des aigris mais aussi le sentiment d'iniquité qui parcourt, comme une lame de fond, le pays ?" Or, ce qui ressort de cette longue enquête dirigée par les journalistes Benoît Collombat et David Servenay avec Frédéric Charpier, Martine Orange et Erwan Seznec, c'est que si, à la faveur de la crise, les patrons français semblent montrer profil bas, en réalité, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que rien ne change.
On découvre ainsi, au fil de ce document - 86 articles qui se lisent comme un roman -, que, malgré la crise, malgré les cortèges de licenciements, les dirigeants français continuent de se verser les plus gros salaires européens, qu'ils se gavent de stock-options et amortissent leur chute éventuelle avec des parachutes de plus en plus dorés. On comprend aussi comment les tenants de la contre-révolution libérale, notamment sous les coups de boutoir du lobby des assureurs et de l'industrie pharmaceutique, n'ont pas abandonné, loin s'en faut, l'idée de démanteler le fameux modèle social français.
Derrière l'histoire officielle
En réalité, la crise financière, ajoutée au scandale de "la caisse noire" de l'UIMM (lire l'enquête de Frédéric Ploquin p. 72), lève le voile sur le fonctionnement réel du capitalisme français. Derrière la façade respectable du patronat, au-delà des apparences de l'histoire officielle, celle des manuels scolaires, se profile une autre histoire, secrète, presque indicible, jonchée d'escroqueries, d'arnaques en tout genre et de trafic d'influence à haute dose. Une sorte de "livre noir" où les patrons et leurs représentants syndicaux cohabitent, dans une proximité de tous les dangers, avec le monde politique (lire l'édifiant chapitre consacré à Veolia, dont nous publions des extraits p. 68).
Paradoxalement, à l'heure où certains redécouvrent, non sans cynisme, les vertus du keynésianisme, les plus grandes entreprises, en France comme ailleurs, ne se sont jamais autant affranchies des lois : paradis fiscaux, places financières offshore, triche comptable... Dès lors, doit-on se contenter de "moraliser le capitalisme", comme le proposent les chefs d'Etat du G8, ou bien changer les règles, toutes les règles ? Avant de répondre à cette question, il convient de lire ce livre d'une traite. En voici quelques extraits, en guise d'amuse-bouche.
* Sous la direction de Benoît Collombat et David Servenay, avec Frédéric Charpier, Martine Orange et Erwan Seznec. Ed. La Découverte, 25 €.
Le pillage orgawe
Elle désigne son ventre, et lâche ce cri du coeur : "L'UIMM, je l'ai là !" Une façon assez directe de signifier à son interlocuteur que les dirigeants de la métallurgie lui ont mené la vie dure et ruiné la santé. Avec son chignon sage, son collier de perles, son chat sur les genoux, et son engagement en faveur de l'ordre de Malte, Annick Lepage n'affiche pas les signes extérieurs d'une "gauchiste" en révolte contre l'ordre établi. Pourtant, cette mère de famille aujourd'hui installée en Bretagne est devenue le pire cauchemar de la branche la plus influente du patronat. [...]
Ancienne chargée de mission, de juillet 1996 à novembre 2001, de la Fédération des industries mécaniques (FIM), une composante de l'UIMM, Annick Lepage a dénoncé le détournement de l'argent d'un centre de formation professionnelle de la FIM, Formeca-Formation (ex-Formeca-Fessart), abondé par des fonds publics, notamment par la taxe d'apprentissage. Ce centre a fermé ses portes fin 1997, mais Annick Lepage a payé le prix fort pour avoir osé briser l'omerta. Licenciée économique après un premier arrêt maladie, elle subit depuis un véritable harcèlement de sa hiérarchie et de l'UIMM. Car l'argent de la formation professionnelle et de l'apprentissage constitue une tirelire de plus de 25 milliards d'euros par an, dont plus de 10 milliards viennent des entreprises. La véritable "caisse noire" du patronat, très éloignée des grands principes à l'origine du système.
2 millions d'euros en liquide dans un coffre
[...] Dans son rapport 2008, la Cour des comptes souhaite une "réforme profonde du dispositif" et conclut qu'"une grande opacité continue d'entourer les conditions de collecte et d'allocation des fonds" de la taxe d'apprentissage (instituée en 1925). [...]
Autre exemple : une enquête judiciaire ouverte en 2002 a montré, après cinq ans d'investigations, que près de 11 millions d'euros d'argent public ont été détournés par l'Opcareg, un organisme (rebaptisé depuis Opcalia) chargé de collecter l'argent de la formation professionnelle en Ile-de-France. Le patron de l'Association régionale de la formation professionnelle (ARFP) était alors Philippe Chodron de Courcel, cousin de Bernadette Chirac et membre du Medef Ile-de-France.
Dès 1997, Annick Lepage a été le témoin de dévoiements similaires. "Il s'agissait de la mise en place volontaire de détournements des fonds alloués à la formation professionnelle", explique l'ancienne chargée de mission. De quelle façon ? "D'abord, par le biais de stagiaires bidons, détaille-t-elle. Le centre de formation et l'entreprise reçoivent des subventions pour un jeune en apprentissage qui, en réalité, n'existe pas ! Les attestations de présence de jeunes fictifs sont signées par quelqu'un d'autre." Annick Lepage a pu le constater personnellement en épluchant les dossiers de préinscription de jeunes qui n'ont finalement pas été retenus par le centre de formation. Leurs dossiers ont quand même été enregistrés, et l'argent empoché...
"L'argent de la formation professionnelle constitue le plus gros financement occulte de l'UIMM, estime Annick Lepage, par le biais d'associations comme l'Adase pour laquelle nous devions apporter notre contribution." L'Adase (Association pour la documentation et l'assistance des entreprises) fait office de maison d'édition pour l'UIMM. Lors de leurs investigations, les enquêteurs en charge de l'affaire de l'UIMM ont eu la grande surprise de saisir près de 2 millions d'euros en liquide dans le coffre-fort de l'association. [...]
Le 21 février 2008, Annick Lepage témoigne devant le juge Roger Le Loire, chargé d'instruire l'affaire de l'UIMM. L'ombre du financement politique apparaît au fil de sa déposition. [...] Face au magistrat, Annick Lepage détaille également le lobbying actif de l'UIMM auprès de parlementaires, notamment lors de la réforme du financement de l'apprentissage en 1995. Le texte représentait un manque à gagner de plus de 45 millions d'euros pour la fédération patronale. Un amendement déposé au dernier moment par la députée RPR du Maine-et-Loire Roselyne Bachelot permet d'exclure l'UIMM du champ de la réforme... Roselyne Bachelot a toujours éludé les questions des journalistes à ce sujet. [...]
Confirmant en tout point le témoignage d'Annick Lepage, la liste des dérives dressées par le Service central de prévention de la corruption (SCPC) est impressionnante : "faux contrats" où "le stagiaire n'existe pas", "structure écran entre le payeur et l'organisme de formation", "retour sur commission", "diversification et opacification des circuits financiers", etc. Avec cette conclusion qui aurait dû alerter les pouvoirs publics : "Tous les éléments utilisables pour des détournements et la constitution de caisses noires peuvent être mis en place relativement facilement." Ce rapport explosif restera dans un placard.
C'est vraiment un système mafieux !
Les enjeux financiers sont tels que les pouvoirs publics n'ont guère eu l'intention de s'attaquer à la tuyauterie percée de la formation. [...] D'autant qu'il permet aux branches professionnelles, aux chambres de commerce, mais aussi aux syndicats d'alimenter allégrement leurs appareils et de financer leurs permanents. Ce "magot" de la formation est évalué à plus de 170 millions d'euros par an pour les confédérations syndicales. "Pour récupérer en partie l'argent de la formation professionnelle, on s'arrange avec ces centres formateurs qui surfacturent leurs prestations - ou facturent carrément des formations fictives - et l'on reverse ensuite discrètement aux syndicats une partie des bénéfices indus", explique un témoin direct.
En 2006, les crédits pour la formation des conseillers prud'homaux se montaient à 33,2 millions d'euros. "Une partie importante - plus de la moitié - est utilisée à d'autres fins, estime Jean-Claude Lam, directeur de 1988 à 2004 de Prudis-CGT, l'institut de formation des conseillers prud'homaux CGT. En interne, l'argument de la CGT est que la formation juridique est moins prioritaire que la lutte pour les revendications." Et gare à celui ou celle qui brise la loi du silence, comme Annick Lepage. Le 24 octobre 1997, elle constitue un dossier contenant toutes les preuves des dérives au sein de la FIM. Sans susciter la moindre réaction de sa présidente, Martine Clément. L'affaire remonte au sommet de l'UIMM. Denis Gautier-Sauvagnac et son bras droit Dominique de Calan sont alertés. Les services juridiques du GIM [Groupement des industries métallurgiques] sont chargés de préparer le dossier de licenciement d'Annick Lepage. Daté du 12 janvier 1999, un courrier de Dominique de Calan, adressé aux présidents des chambres syndicales territoriales, prouve la parfaite connaissance des dérives du système par la hiérarchie patronale. Le même Dominique de Calan, par ailleurs promoteur zélé de l'apprentissage dans le système scolaire, dément avec vigueur toutes les affirmations d'Annick Lepage.
"Ce dossier est extrêmement gênant, affirme Annick Lepage. J'y démontre que les membres du conseil d'administration du centre de formation sont les mêmes que ceux de la direction générale de la FIM ! Ces derniers ne pouvaient donc pas ignorer les dérives du centre de formation. Ils ont signé tous les procès-verbaux des assemblées générales." Jusqu'à son licenciement, l'ex-chargée de mission de la métallurgie explique avoir vécu un véritable calvaire : menaces, écoutes téléphoniques, etc. Une ambiance lourde qui donne même le vertige au directeur général de la FIM de l'époque, lorsqu'il apprend le sabotage du véhicule d'Annick Lepage : "Mais alors, c'est vraiment un système mafieux..."
La triche,vade-mecum des affaires
En décembre 2001, Enron, l'une des plus grandes entreprises américaines, fait faillite : elle avait manipulé ses comptes en transformant en bénéfices des pertes occasionnées par ses opérations spéculatives sur le marché de l'électricité - cette faillite provoquera celle de la société d'audit Arthur Andersen, en charge des comptes d'Enron. Une affaire Enron serait-elle possible en France ? Au vu de la place de plus en plus imposante que prend la rubrique faits divers dans la presse économique, la question a déjà sa réponse. Avec le recul, on ne peut que pointer la position équivoque des grands cabinets d'audit internationaux - Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Pricewater-houseCoopers, les big five ne sont plus que quatre depuis la chute d'Arthur Andersen - supposés jouer les vigies de l'éthique : monopolisant les activités de conseil, en France comme ailleurs, ils refusent rarement de certifier les comptes d'un grand groupe quand celui-ci est un bon client. Cette double casquette n'est pas nouvelle, mais jamais avant les années 90 le patronat n'avait tenté de faire croire qu'elle ne posait aucun problème déontologique.
La duplicité des pratiques patronales ne s'arrête pas là. Qu'elle porte sur la corruption internationale pour conquérir des marchés à l'export, sur les pratiques fiscales visant à soustraire de l'assiette de l'impôt le plus de revenu possible ou sur les méthodes de renseignements utilisées par les multi-nationales, la guerre économique semble ne plus avoir de limites ou de frontières. En mars 2009, une pittoresque affaire illustre la dérive de ces entreprises qui se comportent comme des Etats : la démission fracassante de Thierry Morin, PDG de l'équipementier automobile Valeo. Il est débarqué par son conseil d'administration, officiellement pour "divergences stratégiques" face à la crise. Surprenant pour un homme qui a passé vingt ans dans l'entreprise, dont huit à la diriger. Un mois plus tard, RTL révèle que Thierry Morin a fait poser des micros pour enregistrer les réunions du conseil d'administration où son absence est requise, en particulier lorsqu'il s'agit d'évoquer sa rémunération. Un dispositif clandestin d'écoutes installé trois mois avant son départ et dont le conseil n'a pas été informé. "Son seul but était de mieux retranscrire les débats", se défend l'intéressé dans une lettre adressée à son successeur. L'enjeu ? Le salaire annuel de Thierry Morin, ramené de 1,5 à 1,1 million d'euros en février 2009. Sans oublier son golden parachute - 3,26 millions d'euros d'indemnités de départ -, également au centre de la polémique. Peu de voix se sont alors élevées dans le patronat pour condamner de tels agissements. Seraient-ils à ce point généralisés dans les sociétés cotées ?
Veolia,la pouponnière des élus sans mandat
Aucune entreprise en France n'a su placer ses hommes aux carrefours du pouvoir et choyer les maires, députés et ministres comme le fait Veolia. Avec 320 000 salariés dans le monde en 2009, dont 100 000 en France, ce géant sait tout faire ou presque pour les municipalités. Distribution d'eau, enlèvement des ordures ménagères, chauffage urbain, transports publics par bus, tramway ou bateau, le numéro un mondial des services aux collectivités fait preuve d'un indéniable savoir-faire technique, mais également d'une maîtrise hors du commun des circuits de décision, qu'il s'agisse des longues procédures officielles ou des raccourcis officieux. Il travaille pour 9 000 communes françaises, soit une sur quatre. Les élus locaux sont ses interlocuteurs traditionnels et la politique son milieu naturel. Son histoire sinue en permanence à la lisière du public et du privé.
Supposons par exemple qu'Henri Proglio, PDG de Veolia depuis 2000 [et désormais numéro un d'EDF], ait eu besoin d'un renseignement ou d'un coup de pouce dans le gouvernement de François Fillon au printemps 2009. Un dossier qui s'enlise, une préfecture qui traîne des pieds, un souci avec une association de défense de l'environnement : qui appeler ? Il n'a que l'embarras du choix. Si le souci concernait le ministère de l'Economie et des Finances, il pouvait compter sur Stéphane Richard, directeur de cabinet de la ministre Christine Lagarde depuis 2007 [désormais numéro deux de France Télécom]. S'il fallait plutôt frapper à la porte du ministère de l'Agriculture, aucun problème : Judith Jiguet, directrice adjointe du cabinet du ministre Michel Barnier, est une ancienne chargée de mission auprès du directeur banlieue de Paris de Veolia Eau. Si l'épineux dossier du jour concernait l'Ile-de-France, il suffisait d'appeler André Santini, alors secrétaire d'Etat à la Fonction publique, maire d'Issy-les-Moulineaux et surtout président du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif), avec lequel Veolia entretient d'excellentes relations. Ce sera l'occasion de lui demander des nouvelles de son frère, Dominique Santini, ancien directeur de l'immobilier de Veolia.
Sans oublier, toujours au gouvernement, Eric Besson, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, qui a dirigé la Fondation Vivendi de 1998 à 2002. Au pire, Henri Proglio peut éventuellement déranger Rachida Dati, dont il est proche à titre personnel. C'est avec elle qu'il est arrivé au Fouquet's le soir du second tour de l'élection présidentielle, pour y fêter la victoire de Nicolas Sarkozy. [...]
La démonstration vaut également à l'échelon municipal. A Paris, Veolia peut compter sur Jean-Marc Boulenger de Hautecloque, élu du XVe arrondissement, directeur de la communication d'Onyx, filiale propreté de Veolia. Son directeur des collectivités publiques, Jean-Pierre Frémont, a lui aussi été élu du XVe arrondissement, de 2001 à 2007. En Bretagne, il peut s'appuyer sur son délégué aux relations internationales, Pierre Victoria, député PS du Morbihan de 1991 à 1993, conseiller en communication dans les années 90 du maire de Rennes, Edmond Hervé. Il peut également solliciter Marcel Rogemont, député PS d'Ille-et-Vilaine : battu en 2002, il s'est immédiatement recasé chez Veolia. Il est devenu conseiller général du département en 2008. [...]
Des pratiques identiques chez Suez-Lyonnaise...
Le grand concurrent de Veolia, la Lyonnaise des eaux (qui deviendra Suez-Lyonnaise des eaux après sa fusion avec la Compagnie de Suez en 1997), n'est pas en reste. Jérôme Monod, qui a dirigé le groupe pendant vingt ans (de 1980 à 2000), est très proche de Jacques Chirac. La responsable des relations institutionnelles du groupe, Valérie Alain, est par ailleurs maire adjointe UMP de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Suez a également recyclé le commissaire européen à la monnaie unique Yves-Thibault de Silguy (proche de l'UMP) lorsqu'il a quitté Bruxelles. De 1999 à 2006, ce haut fonctionnaire reconverti dans les affaires avait un bureau au siège de Suez, où il venait vraiment travailler tous les matins, en tant que directeur général aux affaires internationales. La précision peut sembler superflue. Les exemples suivants montrent qu'elle ne l'est pas.
Fin 1992, alors que se profilait un désastre pour le Parti socialiste aux législatives de mars 1993, une de ses filiales a embauché Monique Lang, épouse de Jack Lang, jusque-là chargée de mission au cabinet de son époux, ministre de l'Education nationale de 1992 à 1993. La filiale en question, la Compagnie auxiliaire de services et de participations (Caspar), lui a versé de janvier 1993 à 1994 un salaire de 25 000 F nets par mois (3 800 €). Interrogée en 1997 par le Canard enchaîné qui avait révélé l'affaire, Monique Lang avait admis n'avoir "jamais avoir mis les pieds au siège de la Caspar" et ne pas avoir de traces écrites de ses prestations. Elle mettait en avant un travail de mise en relations, de prises de contact... La Lyonnaise a également embauché, de juin 1992 à janvier 1994, Marie-José Carignon, la soeur d'Alain Carignon (maire de Grenoble de 1983 à 1995), pour 27 000 F par mois (4 115 €). Elle était attachée commerciale pour la région Rhône-Alpes et travaillait sans laisser de traces, à l'instar de Monique Lang.
Bien entendu, il ne suffit pas de connaître un élu ou d'avoir fait une faveur à sa femme ou sa soeur pour plier une collectivité à ses moindres désirs. La première adjointe du maire de Paris depuis 2001, Anne Hidalgo, a été de 1996 à 1997 chargée de mission auprès du directeur du personnel de la Compagnie générale des eaux (CGE). Cela n'a pas empêché Bertrand Delanoë de faire voter en 2008 le retour en régie municipale de la distribution de l'eau à partir de 2010 (elle avait été privatisée en 1985, la CGE prenant la rive gauche et la Lyonnaise des eaux, la rive droite).
Sur la durée, néanmoins, cette politique paye. La longévité de Veolia sur certains contrats ferait presque douter de l'existence même du code des marchés publics. Le groupe tient les transports en commun de Toulon depuis 1949, ceux du Havre depuis plus d'un siècle. Il assure à Nice la distribution d'eau et l'assainissement, le ramassage et l'incinération des ordures ménagères, les parkings, la fourrière auto, les transports en commun par bus et tram, les vélos en libre-service, le chauffage et le nettoyage des bâtiments publics, etc. Depuis 1989, personne n'a gagné un marché à Nice contre Vivendi-Veolia.
Où finissent les bonnes relations, où commence le conflit d'intérêts ? Faute d'une quelconque législation en la matière, Veolia joue sur du velours. Rien n'interdit de recruter des élus. Ceux-ci sont plus nombreux que jamais dans ses rangs, car la décentralisation a éclaté le pouvoir autrefois assumé par l'Etat entre des milliers de collectivités, qu'il a fallu courtiser une par une. Malheureusement pour lui, le groupe s'est ainsi enfoncé dans une zone grise, où chaque appel d'offres remporté risque de susciter des interrogations. [...]
Les élus, premiers responsables
Faudrait-il interdire purement et simplement aux élus locaux de travailler pour des fournisseurs de service de premier rang comme Veolia ou Suez ? La question se posera peut-être un jour, mais elle n'était pas d'actualité dans les années 2000. Le législateur encourageait plutôt les échanges entre les collectivités et les entreprises, via les pôles de compétitivité ou les partenariats publics privés. Côté garde-fou, c'est le vide. Il existe bien une Commission de déontologie, mais elle se prononce seulement sur les éventuels conflits d'intérêts des fonctionnaires d'Etat et des membres de cabinet, avec une autorité toute relative, comme on l'a vu en 2009 avec les nominations de François Pérol à la tête du groupe bancaire des Caisses d'épargne-Banques populaires et de Stéphane Richard à France Télécom. Les élus ne sont pas concernés par la Commission de déontologie. Quant au Service central de prévention de la corruption, créé en 1993 par Pierre Bérégovoy, il se concentre sur l'assistance juridique aux collectivités perdues dans les subtilités du code des marchés publics.
Résultat : à l'intérieur même de Veolia ou de Suez-Lyonnaise, nombre de cadres ne se vivent pas comme des corrupteurs. Ils ressentent, au contraire, les exigences des politiques comme une forme de racket. Si cette vision est sans doute plus confortable pour eux sur le plan moral, elle n'est pas totalement infondée. A la fin des années 80 à Dijon, la Lyonnaise a par exemple accepté de prendre à sa charge la construction du parc de loisirs de la Toison d'or. Tous les spécialistes pronostiquaient son échec, mais le produit était à la mode et Robert Poujade (maire de 1971 à 2001) voulait le sien. Ouvert en 1991, la Toison d'or a fermé deux ans plus tard. L'aventure a coûté 18 millions de francs à la ville et 50 millions à la Lyonnaise (2,7 et 7,6 millions d'euros). En mars 1991, Robert Poujade accordait pour trente ans et sans appel d'offres la distribution et l'assainissement de l'eau de Dijon à la Lyonnaise. "Pour le parc à thème, l'équilibre semble très difficile à réaliser et laisse prévoir un déficit important. L'opération pourra être équilibrée dans un ensemble qui regrouperait le parc à thème et la distribution d'eau", écrivait dans un courrier daté du 6 juillet 1987 une chargée de mission de la Lyonnaise à son président, Jérôme Monod.
Un élu au pouvoir qui accepte une faveur ou un recalé du suffrage universel qui se recase en un clin d'oeil ne peuvent être dupes. Tôt ou tard, sous une forme ou sous une autre, ils savent qu'on leur demandera de renvoyer l'ascenseur, au détriment des citoyens. Ainsi, entre 1992 et 2000, le prix de l'eau a plus que doublé à Dijon, ville mariée à la Lyonnaise pour trente ans. En 2009, malgré les négociations engagées par le successeur de Robert Poujade (le socialiste François Rebsamen), la ville se classait au sixième rang des municipalités de France où le prix de l'eau est le plus élevé. Les Dijonnais n'ont pas fini de payer les cadeaux de la Lyonnaise.
Les patrons en or des années 2000
Brusquement, c'est devenu insupportable. Bien sûr, dans les grands groupes, les salariés connaissaient depuis des années les rémunérations astronomiques de leurs patrons. Ils n'ignoraient plus rien des dispositifs en cascade permettant aux dirigeants de s'enrichir rapidement. Du golden hello - ce fameux chèque de bienvenue - au golden parachute - assurance tous risques même en cas de renvoi pour faute -, en passant par les salaires variables, les bonus, les stock-options, les actions gratuites, les primes et autres gratifications, l'imagination patronale a vraiment été au pouvoir depuis les années 90.
Mais tout cela était au temps de la croissance. Il y avait encore l'alibi de la réussite, de la récompense, du mérite. Avec la crise financière et économique de la fin des années 2000, toutes ces justifications ont disparu. Les groupes plongent, certains s'effondrent, la file des quémandeurs d'argent public grossit à vue d'oeil. Partout, on ne parle que de rigueur, d'économie, du poids excessif des salaires. Les salariés voient les listes des licenciements s'allonger indéfiniment. Et, pendant ce temps, les dirigeants des grands groupes continuent à s'accorder des fortunes. Sans même que le moindre doute ou scrupule sur la légitimité de leur rémunération ne les effleure, les millions pleuvent au nom d'un système qui les a tant favorisés et qu'ils entendent bien perpétuer.
Pendant la crise, les hausses continuent
Tous les coups sont permis, même les plus osés. Ainsi, Thierry Morin, PDG de l'équipementier automobile Valeo, a été débarqué en mars 2009 avec un chèque de 3,2 millions d'euros, laissant son groupe en pleine déconfiture. N'imaginant même pas que cela puisse poser question, Daniel Bouton et l'ensemble de l'état-major de la Société générale, eux, se sont fait accorder des dizaines de milliers de stock-options à un prix bradé en pleine crise financière. Il est vrai que leur performance a été remarquable en 2008 : commençant l'année en fanfare en découvrant des opérations cachées du trader Jérôme Kerviel, qui ont coûté 4,9 milliards d'euros, la banque a dû assumer par la suite le prix de ses engagements hasardeux sur les marchés et de ses achats de produits financiers toxiques [...], avant d'être secourue par l'Etat, comme tout le reste du système bancaire français. Face à la colère des salariés de la Société générale, les dirigeants ont fini par renoncer à leurs stock-options, en avouant qu'ils n'avaient pas mesuré les risques de scandale...
C'est aussi sous la pression des salariés que le PDG de GDF-Suez, Gérard Mestrallet, et son vice-président Jean-François Cirelli, ont rapidement renoncé en mars 2009 aux 800 000 stock-options (d'une valeur d'environ 7,6 millions d'euros) pour l'un et 300 000 (environ 2,8 millions d'euros) pour le second que le conseil d'administration leur avait généreusement attribuées en novembre 2008 pour avoir réussi à arracher GDF au secteur public. Un vrai sacrifice. Mais ils ont gardé un lot de consolation : alors que la direction prônait la rigueur et les économies dans tout le groupe, le salaire annuel pour 2009 de son PDG a augmenté de 18 % pour atteindre 3,1 millions d'euros et celui du vice-président, ancien président de GDF, a triplé, passant de 460 000 à 1,3 million euros.
De malheureux "dérapages", comme tente alors de l'expliquer le Medef ? Difficile à croire : alors que les bénéfices des groupes du CAC 40, cible de toutes les critiques, ont chuté de 40 % en 2008 (un total de 59 milliards d'euros, quand même...), la moyenne des rémunérations de leurs dirigeants n'a baissé que de 13 %. La même année, le salaire annuel moyen d'un patron du CAC 40 - en dehors des stock-options et actions gratuites - s'élève à 2,4 millions d'euros, soit plus de cent soixante années de Smic.
Dix ans plus tôt, ils touchaient à peu près le même montant, mais... en francs, soit une multiplication par plus de six. [...]
Les patrons français juste derrière les Américains
La révolution a été mondiale, mais elle a connu un succès inattendu en France. Alors que les dirigeants français étaient auparavant les moins bien payés d'Europe, ils y sont devenus les mieux payés, devançant de loin les Allemands et même les Britanniques. Seuls les patrons américains gagnent plus qu'eux. En moins de quinze ans, les échelles des revenus se sont totalement déformées. Jusqu'à la fin des années 80, les écarts salariaux varient dans les entreprises de 1 à 30, voire 1 à 40. Un niveau qui fait alors consensus dans la société. En 2007, le rapport est désormais de 1 à 250, voire 1 à 400, notamment dans les banques. C'est à peine moins qu'aux Etats-Unis, où le rapport est de 1 à 500.
[...] Les grands patrons des groupes privatisés - pour la plupart tous encore en poste vingt ans plus tard - restent très discrets sur les fortunes qu'ils ont pu amasser, grâce aux stock-options, salaires variables et autres gratifications. Les sommes reçues en 1999 par Philippe Jaffré, PDG d'Elf, donnent certaines indications. L'ancien président est parti avec des indemnités et un paquet de stock-options, le tout estimé à plus de 200 millions de francs. Il était resté à la présidence d'Elf moins de six ans et partait sur une défaite, après avoir perdu la bataille boursière contre Total. Des chiffres se murmurent pour les autres. Selon leur groupe - industriel ou non -, les heureux élus des privatisations auraient constitué des fortunes personnelles, allant de 20 à 50 millions d'euros. Certains banquiers, notamment Michel Pébereau, qui a mené la privatisation du CCF en 1987 puis celle de la BNP en 1993, auraient même construit des fortunes dépassant les 100 millions d'euros. On comprend mieux pourquoi les derniers dirigeants d'entreprise publique ne rêvent que de privatisation.
Ces grands dirigeants ne tardent pas à faire des émules dans le monde patronal. Tous commencent à rêver de stock-options et de bonus. Les investisseurs étrangers sont accueillis à bras ouverts, on va même les chercher parfois - les capitaux étrangers détiennent désormais 47 % du CAC 40 -, offrant un merveilleux alibi pour adopter les "nouvelles pratiques en matière de rémunération". Les filiales étrangères, en particulier américaines, créent aussi de merveilleuses occasions pour amasser de l'argent en contournant les obligations françaises et en balayant les réticences d'un conseil d'administration. Claude Bébéar, patron d'Axa, a ainsi constitué le début de sa fortune, estimée à 1 milliard d'euros environ à la fin des années 2000 - il n'en revendique publiquement que le dixième -, grâce aux stock-options qu'il s'était fait attribuer dans Equitable, filiale américaine de son groupe. L'équipe dirigeante de Rhône-Poulenc, menée par son ami Jean-René Fourtou, qui en prend la présidence en 1986, a elle aussi su mettre à profit le système. Bien que le groupe pharmaceutique soit encore public à cette date, ils ont obtenu des stock-options de Rorer, une filiale américaine. Lors de la fusion avec Hoechst en 1999 pour créer Aventis, la conversion leur aurait permis d'obtenir un solide capital. On parle de plus 20 millions d'euros. [...]
Le comité de rémunérations, centre nerveux du capitalisme à la française
S'il est un lieu sensible dans un conseil d'administration, c'est bien le comité de rémunération. Le président du groupe en choisit les membres avec toute l'attention que le sujet mérite. Par définition, tous les représentants de l'Etat, même dans les entreprises publiques, en sont exclus : officiellement, ils ne sont pas des administrateurs indépendants ; surtout, ils pourraient mettre des obstacles à ce qui s'y discute. En revanche, il est de bon ton d'y mettre un administrateur étranger, britannique de préférence, car il a, lui, l'habitude des "bonnes pratiques". Et puis, on place des hommes sûrs, mesurés. Hasard ? Ce sont tous des amis qui souvent demandent en retour au PDG de venir siéger à leur propre comité de rémunération. Le capitalisme d'influence à la française, "de barbichette", comme le désignent certains, trouve là sa plus belle traduction.
C'est dans ce "saint des saints" que s'élabore la question cruciale de la rémunération du dirigeant. [...] Comme on est entre amis, ce comité se montre très compréhensif. D'autant que les membres qui y siègent savent que ce qu'ils accordent pourra leur être concédé en retour. Tout cela se passe dans une franche et amicale discussion. Le conseil, lui, n'a qu'à avaliser. "Lorsque le comité de rémunération présente ses décisions, il se contente de lire un rapport des plus brefs où parfois l'ensemble de la rémunération n'est même pas indiqué. On nous donne de vagues comparaisons, un ou deux chiffres, et cela s'arrête là. Il est très mal vu de demander une explication, surtout si des représentants salariés siègent au conseil. Donc tout le monde approuve. En cinq minutes, l'affaire est bouclée. Personne ne sait vraiment ce qu'il a voté", raconte un administrateur familier des conseils du CAC 40.
Plusieurs conseils ont ainsi découvert après coup, lorsque l'affaire a commencé à faire scandale, ce qu'ils avaient accordé. Ainsi, certains administrateurs d'EADS ont appris que Noël Forgeard avait touché 8 millions d'euros d'indemnités à son départ de la présidence du groupe aéronautique en 2006, quand la presse a commencé à en parler. D'autres ont réalisé bien tard le montant du confortable parachute doré qu'ils avaient alloué dans un moment de distraction. Les 6 millions d'euros, par exemple, octroyés à Laurence Danon, en cas de départ de la présidence du Printemps. Responsable de la Commission nouvelles générations du Medef, une instance censée symboliser le renouveau du patronat, celle-ci a dû revoir ses indemnités à la baisse et se contenter de 2,5 millions d'euros. Une misère...
Sur ce dossier, la présidente du Medef, Laurence Parisot, fut étrangement silencieuse. En revanche, elle fit montre d'une indignation spectaculaire lorsqu'elle découvrit l'affaire Vinci. "On en avait le haut-le-coeur", déclara-t-elle publiquement. [...] En plus d'un salaire annuel de 4,3 millions d'euros, qui en faisait le deuxième patron le mieux payé de France, [Antoine Zacharias] s'était vu attribuer un déluge de stock-options, dont le montant était estimé à 250 millions d'euros, et une retraite chapeau dépassant les 2 millions d'euros. Comme si cela ne suffisait pas, le conseil lui avait consenti, au moment de son départ à la retraite en janvier 2006, une prime de remerciement de 13 millions d'euros. Et voilà que, insatiable, Antoine Zacharias demandait maintenant, tel un banquier d'affaires de son propre groupe, une nouvelle commission de 8 millions d'euros pour avoir bien su négocier auprès de l'Etat le rachat des Autoroutes du sud de la France (ASF). [...] Le scandale fut énorme.
Les dirigeants les mieux payés
Jean-Paul Agon - L'Oréal - 14,22 millions d'euros
Bernard Arnault - LVMH - 13,94 millions d'euros
Arnaud Lagardère - Lagardère SCA - 13,64 millions d'euros
Jean-Charles Pauze - Rexel - 10,5 millions d'euros
Bernard Charles - Dassault Systèmes - 8,94 millions d'euros
Source : Proxinvest. Rapport sur les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées.
© 2009 Marianne. Tous droits réservés.

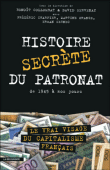




0 commentaires:
Enregistrer un commentaire