
Écoutez l'interview de Philippe Paquet sur EUROPE 1 / Le livre du soir
On l'appelait Madame, lui, le Généralissime. S'aimaient-ils ? La question est secondaire. Elle était son double, sa partenaire. A l'heure des réévaluations, cela suffit à faire de Mme Chiang Kai-shek un personnage fondamental de l'histoire contemporaine.
Elle était née Mayling Soong, troisième fille d'un richissime homme d'affaires converti au protestantisme et aux idées progressistes. A 9ans, on l'expédie aux Etats-Unis. Dix ans d'Amérique, études solides et retour en Chine. Un choc. Elle a presque 30ans lorsqu'elle épouse un militaire au passé douteux transformé en exterminateur des Rouges, Chiang Kai-shek. La voilà première dame à l'influence considérable, bientôt propagandiste de la Chine nationaliste aux Etats-Unis. Sans cette brillante charmeuse, que serait-il advenu de Chiang, dit « Cacahuète » ? De la Chine attaquée par le Japon ? Et de Taïwan ?
Morte à New York en 2003, à l'âge de 103ans, elle valait bien un livre. Celui du sinologue belge Philippe Paquet est « monumental et définitif ». Les mots sont de Simon Leys. On ne saurait mieux dire.
« Madame Chiang Kai-shek », de Philippe Paquet. Préface de Simon Leys (Gallimard, 776p., 28E).
INTERVIEW AVEC L'AUTEUR
Une préface du sinologue Simon Leys, c'est un sésame et un bâton de maréchal ?
Philippe Paquet. Je suis entré en contact avec Simon Leys pour la première fois en 1984. Je rentrais de Chine, où j'avais étudié, je lui ai proposé de participer au comité de rédaction d'une revue, Encres de Chine. Il a accepté. La revue a fait long feu, mais nous nous sommes revus. Nous avons une grande proximité : la même passion pour la Chine, une épouse chinoise, l'aversion du communisme et... la lecture de La Libre Belgique. Pourtant, je ne pensais pas qu'il écrirait la préface. Il en a rédigé très peu, une douzaine. Il ne s'intéresse plus à la Chine politique. Un jour, il m'a dit : "La Chine qui m'occupe n'est plus sur la carte, c'est une région de l'esprit." Je me souvenais aussi de son portrait au vitriol de Chiang Kai-shek, en président d'opérette, dans Images brisées. A ma grande surprise, il a lu le texte, il a suggéré des corrections, évoqué des pistes. Finalement, il a porté à bout de bras ce travail.
Comment en vient-on à consacrer autant de temps à Mme Chiang Kai-shek ?
Le pur hasard. J'ai aperçu Mme Chiang Kai-shek à sa dernière apparition politique, le 7 juillet 1988, au congrès du Kuomintang à Yangmingshan. Je la croyais morte ! Elle avait beaucoup d'allure, j'ai voulu en savoir plus. J'ai découvert cette femme de caractère, cette tête politique - mais je ne l'ai jamais rencontrée - et je lui ai consacré huit années.
Comment avez-vous travaillé ?
Je vais régulièrement aux Etats-Unis et en Chine, les deux pays de Mme Chiang, pour mon journal. Je me suis rendu sur les lieux qui jalonnent sa vie, du Vieux Sud à Taipeh. En Chine continentale, Chiang Kai-shek suscitant un regain d'intérêt depuis que la figure du patriote antijaponais tend à effacer le "bandit" nationaliste, j'ai eu à accès à d'anciennes résidences du couple. J'ai rencontré d'ultimes témoins : le secrétaire particulier de Chiang Kai-shek, le confident des dix dernières années de la vie de Mme Chiang, qui dirigeait la bibliothèque du Congrès, le chef de sa garde personnelle, le jardinier... Et puis, j'ai consulté toutes les archives imaginables, en anglais et en chinois... Je me suis retrouvé à la tête d'une masse de documents telle que j'ai d'abord soutenu une thèse d'histoire à l'université catholique de Louvain.
Quel a été le grand enseignement de ce travail ?
Le réformisme de Chiang Kai-shek. Ce dictateur était un bâtisseur. Les grands chantiers de la décennie de Nankin, entre 1927 et 1937 - construction de routes, ports, chemins de fer, création de liaisons aériennes, d'une banque centrale, d'une monnaie, reconfiguration de la capitale, en damier, à l'américaine, etc. - évoquent inéluctablement les réformes lancées en 1978 par Deng Xiaoping. Même si la question est anti-historique, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le destin de la Chine sans le coup d'arrêt brutal de la guerre avec les Japonais, sans l'arrivée des communistes...
Propos recueillis par Emmanuel Hecht
Mayling Soong, fille du Ciel - Emmanuel Hecht
L'Express, no. 3111 - livres ESSAI, mercredi, 16 février 2011, p. 90-91 Qui connaît l'épouse de Chiang Kai-shek, pourtant sacrée... "plus grand homme d'Asie" ? Sa monumentale biographie se lit comme une histoire de la Chine au féminin. Charlie Soong (1866-1918) est un pionnier. Il est l'un des rares Chinois à étudier en Amérique, à la fin du xixe siècle et le "premier Céleste à recevoir le baptême en Caroline du Nord", selon le Wilmington Star. De retour au pays, il sera rapidement à la tête d'une fortune considérable et de la famille la plus influente de Chine. Car cet homme d'affaires, qui a élevé la stratégie matrimoniale au rang des beaux-arts, est un marieur hors pair. L'aînée de ses trois filles, Ai-ling, épouse un descendant de Confucius à la 75e génération, banquier, puis ministre des Finances et Premier ministre à la fin des années 1930. Chin-ling, la benjamine, ouvre à la famille Soong les portes du pouvoir en épousant Sun Yat-sen, le fondateur du Kuomintang et de la république. Sous Mao, elle sera nommée présidente honoraire de la République populaire. Quant à la cadette, Mayling, à laquelle Philippe Paquet consacre cet ouvrage "monumental" et "définitif", dixit le peu prolixe Simon Leys, elle sera Mme Chiang Kai-shek, première dame de Chine. Des filles de Charlie Soong, on dit alors : la première aime l'argent ; la deuxième, la Chine ; la troisième, le pouvoir. Mais les fils ne sont pas en reste. Tseven fonde la première banque centrale chinoise, avant d'être ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, puis chef de gouvernement dans les années 1945-1947, tandis que ses deux frères sont banquiers. L'évidence saute aux yeux dès les premières pages : la biographie de Madame Chiang (1898-2003), par la personnalité "extraordinaire" (Simon Leys) de celle-ci, et sa parentèle hors du commun, est la clef d'entrée d'un siècle d'histoire : depuis la fin de la dynastie des Qing, jusqu'à la reconnaissance de Pékin par Nixon, en passant par les deux guerres mondiales, le grand mouvement de protestation de la jeunesse du 4 mai 1919, la "décennie de Nankin" du généralissime Chiang Kai-shek, la victoire de Mao, la naissance de la république de Taïwan... Et Philippe Paquet, sinologue et journaliste au service étranger de La Libre Belgique, s'acquitte de sa tâche haut la main, en faisant de cette période tumultueuse et méconnue sous nos latitudes un récit passionnant. Mais revenons à celle qui n'était pas encore, selon l'expression d'un journaliste américain, "le plus grand homme d'Asie". La chance de sa vie aura été d'être prise pour épouse, en second choix, certes, par un général ambitieux, Chiang Kai-shek, jetant son dévolu sur la cadette après avoir été éconduit par l'aînée, veuve de Sun Yat-sen. Cette union d'une carpe - lui, militaire provincial, mutique et rustre - et du lapin - elle, raffinée, polyglotte, cosmopolite - n'est pas dénuée d'affection, mais elle est surtout d'une rare efficacité politique. Mayling lance la carrière du "Napoléon de Nigbo", l'introduit dans la bourgeoisie d'affaires de Shanghaï, qui financera ses campagnes militaires. Hyperactive, infatigable, elle refuse l'effacement imposé aux femmes et s'impose à la direction du Kuomintang. Elle prend la tête de la croisade morale lancée en 1934, sauve Chiang des griffes d'un seigneur de la guerre (magnifique récit de l'"incident de Xi'an" en 1936) - son heure la plus glorieuse - et scelle dans la foulée le front uni des nationalistes et des communistes contre l'occupant japonais. En 1943, elle fait une tournée triomphale dans l'Amérique de son enfance - née à Shanghaï, elle fut élève du très chic collège de Wellesley, près de Boston - pour sensibiliser le pays aux exactions des troupes d'Hirohito. Elle prononce un discours au Congrès, privilège réservé jusqu'ici à une seule femme, avant de s'attaquer à l'abrogation d'une loi interdisant l'immigration chinoise, etc. L'étoile de Mayling pâlit à la fin des années 1960, au fur et à mesure du rapprochement entre Washington et Pékin, et, plus encore, après la mort du généralissime (1975). Mais pas une seule fois elle ne se départit de son humour. Comme le jour de son centième anniversaire, célébré dans son duplex newyorkais, où elle feint de s'interroger : "Que feriez-vous, vous les hommes, sans de jolies femmes comme nous ?" Le Figaro, no. 20667 - Le Figaro Littéraire, jeudi, 13 janvier 2011, p. 6 C'est une des femmes les plus fascinantes, les plus douées et les plus belles du monde. La fascination provient de ses autres caractéristiques mais, en tout premier lieu, de quelque chose d'indéfinissable que nous appelons le charme. » Cette appréciation du chargé d'affaires américain à Taïwan en 1950 atteste l'extraordinaire aura dont n'a cessé d'être entourée Mayling Soong, épouse de Chiang Kai-shek, rival malheureux de Mao, qui, après avoir été expulsé de Chine continentale par ce dernier au lendemain du second conflit mondial, se replia sur l'île de Formose, où il régna en maître jusqu'à sa mort, en 1975. Autant le « généralissimo » semblait dénué de charisme, mal dégrossi, resté très proche du paysannat chinois dont il était issu, autant sa flamboyante épouse polarisait tous les regards. De Wendell Willkie, adversaire républicain de Roosevelt, à Jean Monnet, un temps conseiller de son mari avant guerre, on lui a prêté d'innombrables soupirants. Sinologue et journaliste belge, Philippe Paquet a, lui aussi, succombé à ses attraits - non sans garder, heureusement, son sens critique, comme le prouve la monumentale et magistrale biographie qu'il vient de lui consacrer. Son destin hors norme, Mayling le dut d'abord à sa famille, l'une des plus puissantes de Chine, l'une des plus romanesques aussi. Sans forcer le trait, on peut dire que l'ex-empire du Milieu fut longtemps dominé par les fils et les filles de l'étonnant pasteur Soong, qui, parti très jeune pour l'Amérique, était retourné dans son pays pour faire fortune en vendant des bibles. Élevés dans de prestigieuses institutions américaines, quatre de ses six enfants furent constamment sous les feux de la rampe. Préférée de son père, dont elle avait hérité le sens des affaires, Ai-ling, l'aînée, avait épousé le soixante-treizième descendant de Confucius, M. Kung, l'un des hommes les plus riches de Chine, futur directeur de la Banque nationale. Ching-lin, la deuxième fille, prit, quant à elle, pour mari Sun Yat sen, le fondateur et premier président de la République, l'inspirateur du Kuomintang; bien des années après la disparition de son époux, fidèle à l'aile gauche du parti, elle devait se rallier à Mao et devenir ainsi vice-présidente de la République populaire de Chine tandis que sa soeur Mayling était la première dame de Taïwan aux côtés de Chiang Kai-shek. T. V. Soong, l'un des fils du pasteur, révéla lui aussi une envergure exceptionnelle. Très américanisé, réputé libéral, il mena une grande carrière de banquier avant d'assumer un temps, aux côtés de son beau-frère qu'il n'appréciait guère, les fonctions de ministre des Finances. Ambassadrice de l'ombre Mayling considérait l'Amérique, où elle avait en partie grandi, comme sa seconde patrie. Devenue veuve, elle quitta d'ailleurs Formose et se retira à Manhattan, où elle mourut, à l'âge de cent cinq ans, en 2003. Dans son livre, fruit d'une enquête inouïe dans le monde entier, Philippe Paquet montre combien ces liens comptèrent. Aux États-Unis, Mme Chiang devait être longtemps la meilleure ambassadrice de son pays, subjuguant nombre de hauts responsables, à la notable exception de Harry Truman, manifestement allergique à sa personne. Sur Roosevelt, son ascendant apparaît certain et ce fut sous sa présidence que le Congrès la reçut en grande pompe, honneur insigne et rarissime. « Le grand homme de l'Asie » La légende qui l'entourait, Mayling la devait à la fois à sa puissante personnalité, à l'influence qu'elle exerçait sur son mari et, par son intermédiaire, sur les affaires publiques. En plusieurs circonstances, Philippe Paquet l'établit parfaitement, son action s'avéra déterminante. En décembre 1936, lorsque Chiang Kai-shek fut séquestré à Xi'an par Chang Hsueh-liang, surnommé « le Jeune Maréchal », elle sauva littéralement la vie de son époux avant de favoriser la constitution d'un front uni des communistes et des nationalistes contre l'envahisseur japonais. En 1943, de nouveau, elle changea le cours de l'histoire en obtenant de Roosevelt la rétrocession de l'île de Formose à la Chine, après la défaite nipponne. Sans ce sanctuaire, Chiang Kai-shek et ses fidèles se seraient trouvés totalement démunis au lendemain de la victoire des communistes. Au temps de sa splendeur, Mme Chiang fut souvent attaquée, accusée de se comporter en diva capricieuse, voire de couvrir des opérations financières douteuses. Truman, notamment, se montra fort réceptif à ces rumeurs. Philippe Paquet n'élude pas la question mais la ramène à de justes proportions. Il souligne aussi les aspects incontestablement positifs de l'activité incessante déployée par son héroïne. Sous la férule de Chiang Kai-shek, si Taïwan ne constitua certes pas un modèle de démocratie, du moins ses habitants échappèrent-ils aux tragédies du Grand Bond en avant et de la Révolution culturelle. En une trentaine d'années, grâce à une réforme agraire et à une industrialisation menées à marche forcée, l'île devint aussi une puissance économique de premier plan. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'action en coulisses de celle dont un journaliste a pu écrire : « Le plus grand homme d'Asie, c'est elle. »
Mme Chiang Kai-shek, diplomate et diva - Éric Roussel
May-ling Soong, éternelle première dame de Chine - Thomas Wieder
Le Monde - Monde des livres, samedi, 18 décembre 2010, p. LIV1 Ils étaient six. Trois filles et trois garçons. L'aînée, Ai-ling, épousa un richissime homme d'affaires chinois qui fut premier ministre à la fin des années 1930. La deuxième, Ching-ling, se maria avec Sun Yat-sen, le « père de la Chine moderne », avant de devenir elle-même, sous Mao, présidente honoraire de la République populaire. Tseven, l'aîné des garçons, fonda à l'âge de 30 ans la première banque centrale chinoise, fut ministre des finances et des affaires étrangères, puis dirigea le gouvernement de 1945 à 1947. Si les deux cadets ne furent « que » de puissants banquiers, la plus jeune des soeurs, pour sa part, surpassa le reste de la fratrie en termes de notoriété et de longévité : née à Shanghaï en 1898 et morte à New York en 2003, May-ling Soong fut pendant quarante ans « Mme Tchang Kaï-chek », autrement dit la première dame de Chine puis de Taïwan. Un tel destin, pour glorieux qu'il fût, justifiait-il une biographie de près de 800 pages ? Journaliste à La Libre Belgique, Philippe Paquet nous convainc que oui. D'abord parce que cette femme à l'énergie hors du commun, qui survécut à des dizaines de séjours à l'hôpital, fut le témoin direct d'un demi-siècle d'histoire sur lequel la bibliographie, en français du moins, n'est pas pléthorique. La suivre, c'est assister aux derniers feux de la dynastie des Qing, à la veille de la première guerre mondiale; revivre l'espérance du 4 mai 1919, ce jour de grandes manifestations qui fit entrer la Chine dans le XXe siècle; pénétrer, enfin, dans les arcanes du pouvoir de Tchang Kaï-chek, d'abord au temps où celui-ci essaya de se rendre maître de la Chine continentale, puis quand, vaincu par les communistes en 1949, il se replia à Taïwan en attendant une revanche qui ne vint jamais. Si May-ling Soong méritait un portrait si fouillé, c'est toutefois pour une autre raison : aussi extravertie que son époux était impénétrable, elle exerça, dès son mariage, une influence politique décisive. Ce qui fit dire un jour à un journaliste, impressionné par l'audace de cette première dame bien décidée à ne pas jouer les seconds rôles : « Le plus grand homme d'Asie, c'est elle. » Décisive, l'influence de May-ling Soong le fut dès le mitan des années 1920. Sun Yat-sen venait de mourir, sa succession était ouverte, et aucun prétendant ne s'imposait véritablement. Respecté comme général, mais trop anticommuniste pour une partie du Kuomintang (le parti nationaliste fondé par Sun Yat-sen en 1912), Tchang Kaï-chek bouillonnait d'ambition. Il eut alors une idée : épouser la veuve du dirigeant défunt. Elle refusa, mais lui s'entêta, et, à défaut de la veuve, il finit par épouser la soeur de celle-ci... après avoir toutefois mis près de deux ans à la convaincre ! Cette alliance de raison profitait à chacun des partis. En entrant dans la famille du père fondateur de la République, Tchang en devenait l'héritier naturel. Mais il contractait en même temps une dette à l'égard de celle, de onze ans sa cadette, qui lui avait permis d'accéder au faîte du pouvoir. Et qui saurait le lui rappeler. Incontournable, la jeune Mayling Soong le devint dès les premières années de son mariage. D'abord en s'imposant comme la « force motrice » du « Mouvement pour la vie nouvelle », la grande croisade morale lancée par le Kuomintang en 1934. Puis surtout en jouant un rôle clé dans la survie politique de son mari, qu'elle contribua à faire libérer après que celui-ci eut été pris en otage en Mandchourie par un seigneur de la guerre, en 1936. Les pages que Philippe Paquet consacre à cet événement, resté célèbre sous le nom d'« incident de Xi'an », sont passionnantes. L'auteur ne se contente pas, en effet, de rappeler l'importance politique de cette libération, qui se fit au prix de l'acceptation, par Tchang Kaï-chek, d'une alliance historique avec les communistes sous la forme d'un « front uni » contre l'envahisseur japonais. Il montre aussi très bien comment, au lendemain de la prise d'otages, le Kuomintang transforma la première dame en véritable icône de la résistance anti-nippone. Il faut dire qu'elle-même se plia volontiers au jeu, avec un redoutable sens des affaires. Ainsi, pressée par les journalistes de livrer sa version de l'incident de Xi'an, elle fit monter les enchères et finit par vendre son témoignage pour 12 000 dollars au correspondant du New York Times en Chine. « Le charme de Cléopâtre » Le succès de l'opération incita le régime chinois à faire de sa first lady, incomparablement plus à l'aise en public que son mari, sa principale ambassadrice à l'étranger. Le sommet fut atteint en 1943 : pendant deux mois, en pleine guerre, May-ling Soong sillonna les Etats-Unis pour sensibiliser l'opinion publique aux souffrances infligées au peuple chinois par les soldats japonais. Logée plusieurs jours à la Maison Blanche, invitée vedette d'un meeting organisé à Los Angeles en présence de 30 000 spectateurs et de quelques stars d'Hollywood comme Marlene Dietrich, Rita Hayworth et Henri Fonda, elle eut jusqu'au privilège d'être la deuxième femme - et la première personnalité chinoise - à prononcer un discours devant le Congrès. L'Amérique était conquise - même au fin fond du Midwest, comme l'atteste l'article que consacra le Kays News, un quotidien du Kansas, à cette « femme qui manie l'épée comme Jeanne d'Arc et qui a la sagacité de la reine Elizabeth, la diplomatie de la Grande Catherine et le charme de Cléopâtre »... Si May-ling Soong devint si populaire aux Etats-Unis, toutefois, c'est aussi pour une autre raison : ancienne élève au Wellesley College, une très « select » université pour filles située dans la banlieue de Boston, cette chrétienne fervente avait gardé de ses années étudiantes à la fois une sincère vénération pour les valeurs américaines et de solides réseaux d'influence, notamment religieux, qu'elle mobilisa avec un art consommé de la diplomatie. Reste à savoir pour quel bénéfice. Se fondant sur une vaste documentation, chinoise et anglo-saxonne, Philippe Paquet apporte une réponse nuancée. Si son rôle fut important dans l'abrogation, en 1943, de la législation américaine qui interdisait l'immigration des ressortissants chinois et leur accès à la citoyenneté depuis la fin du XIXe siècle, elle échoua, en revanche, lorsqu'elle essaya, à partir de la fin des années 1950, à redorer auprès des Américains l'image de plus en plus négative qu'ils avaient du régime de Taïwan. Continuant à tonner contre ces « Tartares d'aujourd'hui » qu'étaient à ses yeux les « troglodytes communistes », elle lutta en vain, à la charnière des années 1960-1970, contre le rapprochement des Etats-Unis et de la Chine de Mao. Sans comprendre que l'époque avait changé. Et sans comprendre non plus, depuis le duplex de Manhattan où elle s'installa après la mort de son mari, que le temps où la presse célébrait « la plus américaine des Chinoises » était désormais révolu. Une biographie remarquable restitue le destin de la femme de l'homme politique chinois Chiang Kai-shek. Qui connaît, en France, une certaine Mayling Soong ? Bien peu de monde, sans doute. Cette personne fut pourtant une véritable star dans les années d'après-guerre. Son beau et fin visage, sa silhouette élégante firent plus d'une vingtaine de fois la couverture de Life ou du Time, magazines qui avaient au siècle dernier des tirages pharaoniques. Au milieu des années 1960, les sondages comptaient même Mayling Soong parmi les dix personnalités "les plus aimées au monde" ! Qui donc est cette si célèbre inconnue ? Peut-être notre ignorance se dissipera-t-elle si nous donnons à cette dame le nom de son mari : Mayling Soong fut, à partir de 1927 et sa vie durant, qui fut longue - elle meurt à 105 ans en 2003 - Madame Chiang Kai-shek. C'est à cette personne que Philippe Paquet consacre une biographie ébouriffante dont Simon Leys estime, dans sa lumineuse préface, et en toute simplicité, qu'elle est "monumentale" et "définitive". On ne saurait mieux dire. Cette biographie est "monumentale", car la vie et l'action de Mayling Soong s'insèrent et même se confondent avec l'histoire contemporaine de la Chine, son engagement dans la Seconde Guerre mondiale, l'affrontement titanesque, enfin, dans l'après-guerre, entre le communisme et le monde libre. Cette biographie est "définitive", car il est difficile d'imaginer qu'on puisse, avant longtemps, plonger plus profondément dans un océan d'archives et les mieux maîtriser dans leurs deux dimensions, chinoise et occidentale. Ces compliments distribués, il faut ajouter que les qualités d'écriture et le sens du récit dont l'auteur est généreusement doté sont à la hauteur d'une histoire de vie dont l'originalité et le caractère aventureux ne sont pas la moindre des distinctions. Bien plus qu'une interprète auprès de son mari L'histoire de Mayling Soong, c'est d'abord l'histoire d'une famille. Elle commence avec l'expatriation aux Etats-Unis, à la fin du XIXe siècle, du patriarche, Charlie Soong. Converti au christianisme et de retour en Chine, Charlie Soong, le père de Mayling, va bâtir une fortune considérable. Il tient, en oligarque dirait-on aujourd'hui, un rôle de premier ordre dans la jeune République chinoise en proie aux désordres des seigneurs de la guerre et des convoitises du voisin japonais. Mais la plus brillante de ses entreprises est sa stratégie matrimoniale. Sa fille aînée, Ailing, s'allie avec une autre puissante famille shanghaïenne, celle des Kung. La cadette, Ching-ling, quant à elle, se marie avec le père de la République chinoise, Sun Yat-sen. La benjamine, enfin, Mayling, épouse en 1927 le chef du Kuomintang, Chiang Kai-shek. Philippe Paquet rapporte plaisamment ce qui se disait de ces trois dames au regard de leurs alliances : la première aimait l'argent, la deuxième, la Chine, et la troisième, le pouvoir. De Mayling, en effet, on a pu dire qu'elle fut "le grand homme de l'Asie". Elle tint auprès de Chiang Kai-shek un rôle essentiel que sa double culture, américaine et chinoise, explique largement. Comme son père et ses frères et soeurs, la jeune Mayling Soong a fait ses études aux Etats-Unis. Elle y a acquis une parfaite maîtrise de la langue anglaise et, plus largement, une connaissance signalée de nos humanités. De sorte que, dans les relations avec les grands de ce monde et plus précisément avec les Américains, Mayling sera plus qu'une interprète auprès de son taciturne de mari, elle sera un véritable pont entre la Chine et l'Occident. Dans le combat finalement perdu contre le communisme, Mayling aura déployé d'incessants efforts. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle échoue à convaincre Churchill de faire du front chinois contre les Japonais un théâtre de bataille principal. La défaite des nationalistes, en 1947, étant consommée, elle essaiera sans relâche d'entraîner les Etats-Unis dans la reconquête du continent. Mais malgré les efforts du lobby chinois dont elle est, à Washington, l'égérie, elle ne convaincra pas les autorités américaines pour qui le danger communiste reste d'abord soviétique. La reconnaissance par Nixon de la Chine communiste sonnera le glas des espoirs de madame Chiang. Elle vivra toutefois ses dernières années aux Etats-Unis. Un peu oubliée dans sa deuxième patrie et alors même que, dans la Chine éternelle, Mayling Chiang et son mari, nous dit Philippe Paquet, "font l'objet d'une réhabilitation officielle pour leur patriotisme et leur contribution à la modernisation du pays à l'ère précommuniste". Grand livre, bel ouvrage.
Une biographie retrace l'étonnant parcours de la femme de Tchang Kaï-chek
La dame de Shanghai - Marc Riglet
Lire, no. 391 - histoire, décembre 2010, p. 88
Le Soir - 1E - LIVRES, vendredi, 1 avril 2011, p. 41
Un siècle d'histoire de la Chine, c'est ce que Philippe Paquet entend retracer dans un ouvrage des plus savants et les plus captivants qui soient. Et, quoiqu'il s'agisse d'une biographie, il ne trompe pas sur la marchandise. La femme dont il nous conte le destin a en effet vécu cent six ans, à cheval sur le XXe siècle : née en 1897 à Shanghai, elle mourut à New York en 2003. De plus, son destin fut, de fait, étroitement lié à celui de la Chine, au point d'en avoir été la première dame durant des décennies, et d'incarner sa nation et sa culture durant beaucoup plus longtemps.
Cette figure majeure, née Mayling Soong, mieux connue sous le nom de Madame Chiang Kai-shek n'avait, aussi étrange qu'il puisse y paraître, eu droit qu'à d'approximatives évocations biographiques. Cette lacune est à présent comblée par Philippe Paquet. L'entreprise du sinologue belge, collaborateur à La Libre, est qualifiée dans la préface que lui consacre Simon Leys de « monumentale » et « définitive » . On ne saurait mieux dire. Le volume de 750 pages est imposant, certes, mais il n'intimide guère, tant il est écrit avec élégance et, souvent, humour. Il demeurera la référence incontournable pour tous ceux qui s'approcheront de cette femme d'exception dont le parcours éclaire de façon stupéfiante l'époque dont nous sommes issus, et un pays dont l'importance dans le monde ne cessera de croître.
Paquet a parcouru le monde pour traquer son modèle, puisque la petite Mayling fut éduquée aux Etats-Unis, pays qu'elle rejoindra après la mort de son époux, premier président de la république chinoise dont l'accession au pouvoir avait été préparée par Sun Yat-sen (lui-même marié avec une autre fille Soong) et qui en fut chassé par Mao. De première dame de l'Empire du Milieu, elle devint celle de Formose, l'actuelle Taïwan. Au fil de son parcours, c'est tout un jeu d'influences internationales que Paquet nous retrace, montrant notamment le rôle des missions chrétiennes dans l'édification de la Chine contemporaine.
Avec un luxe de détails et de nuances inouï, l'auteur nous raconte une véritable saga où la réalité complexe, mouvementée, passionnante dépasse largement la fiction. On se demande même, plongé dans cette épopée souvent épicée de notations pittoresques, s'il existe un meilleur récit d'un monde en complète mutation dont est né celui où nous sommes immergés aujourd'hui.
Un peu partout, cet exploit a déjà été salué comme un chef-d'oeuvre. Comment ne pas rejoindre la plus justifiée des unanimités dans l'éloge ?

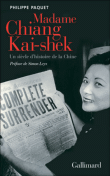 Écoutez l'interview de Philippe Paquet sur EUROPE 1 / Le livre du soir
Écoutez l'interview de Philippe Paquet sur EUROPE 1 / Le livre du soir



0 commentaires:
Enregistrer un commentaire