 Le Point, no. 1938 - Idées, jeudi, 5 novembre 2009, p. 122,123,124
Le Point, no. 1938 - Idées, jeudi, 5 novembre 2009, p. 122,123,124Alain Badiou a aimé la révolution et est devenu l'un des prophètes de la contestation. Philosophe difficile, pamphlétaire acéré, activiste infatigable, ce communiste canal historique parle aussi d'amour.
Badiou : une certaine Idée de l'amour - Propos recueillis par Elisabeth Lévy
Le Point : On attend Lénine ou Mao, et on découvre Comte-Sponville. Sans amour, dites-vous, point de philosophie. Vous devenez fleur bleue ? Alain Badiou : Vous exagérez ! Quand je dis que le philosophe doit être un amant, ou un aimant, c'est une référence très classique à Platon, qui établit un lien intime entre la philosophie et l'amour. La philosophie est amour de la vérité, mais au sens fort de ce terme. Il faut être dans l'élément de l'amour, savoir ce qu'est l'amour pour éprouver l'amour de la vérité. En déployant cette idée, je postule que quatre expériences fondamentales de la vie humaine sont les conditions de la philosophie : la science, les arts, la politique évidemment, et enfin l'amour, qui n'est donc pas une excursion loin de mes terres.
Ne cédez-vous pas à une vision irénique ? Dans votre idée de l'amour comme « revanche du Deux », il y a peut-être du drame, mais pas beaucoup de tragédie. Il n'est guère question de l'impossibilité de l'amour, de sa fin programmée. Je rappelle au contraire qu'il y a non seulement du drame, mais aussi du meurtre, du sang. Il y a peut-être autant de tragédie en amour qu'en politique. L'amour est une chose difficile et, en fin de compte, rare. L'échec, les malentendus, l'épuisement, le négatif, on en a tant qu'on veut. On peut les ressasser - la plainte est une disposition spontanée. L'art s'alimente de la plainte humaine et la sublime en quelque chose qui, en fin de compte, est du plaisir. Mais être philosophe, c'est ne pas trop faire confiance aux dispositions spontanées ou aux opinions dominantes. La philosophie doit donner à l'humanité le courage de la création et de l'affirmation. Sinon, elle ne sert à rien.
Répondant à Lacan qui affirme qu'« il n'y a pas de rapport sexuel », vous prétendez qu'il y a un rapport amoureux. En dehors de votre expérience, qu'est-ce qui vous prouve que le Deux de l'amour n'est pas une chimère ? Je précise que je ne suis pas totalement lacanien, car je crois qu'il y a un rapport sexuel. Cela étant, je ne pense pas que l'amour soit la connaissance de l'autre. Je crois que, dans la durée amoureuse et pas seulement dans l'illumination initiale, peut se construire une expérience du monde décentrée par rapport à la vision individuelle, au narcissisme. Le monde que j'expérimente, la vie qui est la mienne, le temps que j'y passe sont imprégnés du fait que c'est avec l'autre que ça se passe. C'est cela que je nomme l'amour. Le monde du Deux se superposant au classique monde de l'Un.
Vous avez défendu Mai 68 contre les attaques du candidat Sarkozy. Mais l'amour-Meetic, qui a détrôné l'amour mythique, est aussi un héritage de Mai. Vous ne pouvez ignorer que la libération s'est muée en libéralisation. Dans Mai 68, si vous me permettez de le dire trivialement, j'en prends et j'en jette. Dans « L'hypothèse communiste », je soutiens qu'il y a eu quatre Mai 68 dont les bilans sont contradictoires. Le courant que je qualifie de libertin-libertaire revendiquait en effet la sexualité sans rivage, la jouissance pour tous. J'admets tout à fait qu'il a conduit assez directement à la jouissance marchande. Il y a donc quelque chose de vaguement héroïque à maintenir vivantes une autre idée et une autre expérience de l'amour.
La philosophie fait donc lien entre l'amour et la politique. Mais vous aimez l'amour bien qu'il soit violent et la politique parce qu'elle est violente. Cela est une pure légende. Je ne suis pas du tout un amoureux de la violence en politique. Etre acculé à la violence est bien plus un problème qu'une issue. Les seules violences parfois nécessaires et légitimes en politique sont des violences strictement défensives. Même s'agissant de la politique « révolutionnaire », encore que ce mot soit devenu bien obscur, je pense que tout fétichisme de la violence est périlleux. Par ailleurs, il y a des circonstances où la violence est inévitable. Cette idée n'est pas non plus l'apanage des révolutionnaires, elle anime tout autant les impériaux qui font la guerre en Afghanistan ou en Irak, comme ils l'ont faite en Algérie ou au Vietnam.
Vous semblez penser que cette violence, aujourd'hui, est inévitable parce que la société y serait « acculée » par le pouvoir. Citez-moi un seul texte où j'appellerais à la violence ! Il est évident qu'il y a une injustice du pouvoir et que toute injustice est soutenue par la violence qui permet de la perpétuer. Tout le monde voit bien que la société est entièrement bâtie sur la défense acharnée de privilèges et d'inégalités qui ne se maintiennent qu'à grand renfort de lois répressives. Faut-il pour autant opposer la violence à cette violence-là, je n'en crois rien. Les tâches politiques de l'heure relèvent de l'idéologie et de l'organisation, pas du tout de la lutte armée, surtout pas au sens où l'entendent certains groupes. On est tellement loin d'une situation où la violence pourrait être productive que c'est une absurdité.
Le Deux de l'amour est une extension, un agrandissement par rapport au Un de l'individu. Mais le Deux de la politique - ami/ennemi - n'est-il pas un rétrécissement par rapport à la pluralité du monde ? Je ne suis pas un disciple de Carl Schmitt. Je suis très loin de penser que la politique consiste à désigner l'ennemi. Je dis simplement qu'en politique il y a des ennemis, ce qui est une grande différence avec l'amour.
Mais vous définissez bien le XXe siècle comme « le siècle du Réel » et celui du chiffre Deux, de l'antagonisme, du grand Autre ? C'est exact, mais je pense qu'il faut sortir du XXe siècle. Le réel, tel que l'a pensé le XXe siècle politique et révolutionnaire, a été non seulement celui de l'antagonisme, mais aussi celui de la purification. Au bout du compte, l'idée révolutionnaire a été dévorée par une sorte de suspicion généralisée. Il faut penser autrement. Ce qui compte, c'est de créer une nouvelle unité à partir d'une multiplicité, d'intégrer les différences dans un camp multiforme qui inventera un chemin égalitaire nouveau. Et, pour y parvenir, la question des amis est beaucoup plus importante que celle des ennemis.
« Dans l'amour, écrivez-vous, on fait confiance à la différence au lieu de la soupçonner. La Réaction disqualifie la différence au nom de l'identité. » Vous, vous disqualifiez l'identité au nom de la différence. L'amour et la politique ne seraient-ils que deux moyens de se délivrer de l'identité ? Absolument pas ! Il serait absurde de prétendre que les identités ne doivent pas exister puisqu'elles constituent la trame de tout ce qui existe ! Je dis seulement que tout ce qui est vrai, tout ce qui unit les hommes et leur appartient de façon générique est fait à la fois de matériaux identitaires et de leur dépassement. La philosophie est nécessairement la promotion, non des identités, mais de la part universelle dont les identités sont capables. Surtout quand on remet au goût du jour la notion d'identité nationale, qui sent son pétainisme.
En somme, vous rejetez l'amour-fusion, mais vous croyez à la politique-fusion. D'ailleurs, dans communisme il y a communion. Pour moi, le communisme n'a rien à voir avec la communion ou la totalité. La question est de savoir si la norme égalitaire est à l'oeuvre dans le travail collectif. Mais l'égalité ne consiste nullement à réduire les singularités. Simplement, si une vérité intéresse l'humanité tout entière, c'est qu'elle n'est pas réductible aux singularités qui la composent. Je suis le premier à reconnaître l'existence des identités nationales et des historicités distinctes. Mais, en définitive, le cosmopolitisme et l'internationalisme leur sont supérieurs.
On a l'impression que vous sacrifiez aisément la vie concrète à l'Idée. D'où, d'ailleurs, votre mépris pour le nombre de victimes comme critère du communisme ou du fascisme. Vous êtes injuste ! Tout le monde a du sang jusqu'aux oreilles et je trouve intellectuellement honteux qu'on brandisse les morts contre certaines idées, et pas contre d'autres. En 1914, ce sont les régimes parlementaires qui ont organisé une sensationnelle fête des morts. Tous les régimes ont du sang sur les mains et, dans les dernières décennies, les démocraties continuent à en avoir beaucoup, et d'assez bon coeur.
Peut-être, mais, comme l'observe Sloterdijk, l'érotisme de l'avidité l'a emporté sur l'héroïsme, y compris chez les damnés de la terre : les victimes du capitalisme en redemandent. Cela ne m'impressionne pas le moins du monde. A toutes les époques, de larges pans du monde dominé aspirent à partager les valeurs du monde dominant. Bien des serfs souhaitaient un monde où ils auraient été nobles. Il s'agit de faire en sorte que l'énergie populaire, au lieu d'être fascinée par la richesse et l'opulence, se projette dans un monde dans lequel cette division-là n'existerait plus. Ce passage peut être grevé de passions brutales, et même envieuses. Reste que, dans leur ambivalence, ces mouvements de masse sont nécessaires. Ce n'est pas parce qu'il y a mouvement qu'il y a politique. Mais il n'y a pas de politique sans mouvement.
D'où votre admiration pour la Révolution culturelle chinoise, à laquelle vous trouvez une certaine grandeur. Evidemment ! La Révolution culturelle tente de redonner au socialisme épuisé la signification d'un mouvement. Comme le dit Mao, « sans mouvement communiste, pas de communisme ». Alors que les Etats socialistes sont des monstres bureaucratiques, la régénération, dans les années 60, ne peut plus venir du Parti ni même de la masse des gens intégrés vaille que vaille au nouvel ordre. Comme dans le monde entier, elle ne peut venir que du mouvement de la jeunesse, étudiante et/ou ouvrière. Or celui-ci est capable du meilleur et du pire quand il n'est pas structuré par une véritable discipline politique.
Où était le meilleur ? Le meilleur, c'était, comme partout ailleurs, l'idée qu'on allait changer tout ça, renverser les despotes locaux, faire progresser partout, singulièrement dans les usines et les universités, une sorte d'égalité pratique nouvelle. Entre 1966 et 1968, il y a eu des millions de gens dans les rues, des courants, des contre-courants, des masses de journaux, de caricatures, d'affiches.
Dans cette magnifique effusion, les victimes sont-elles les oeufs nécessaires à la fabrication de l'omelette qu'est l'Histoire ? La question des victimes de la Révolution culturelle est singulièrement compliquée. Qui a tué qui ? La séquence a duré une dizaine d'années et il y a eu des victimes à tous les étages de l'appareil et de la société. La Révolution culturelle est peu à peu devenue une guerre civile incontrôlée, et c'est ce qui en a scellé l'échec.
Sous prétexte que les victimes sont recrutées de façon égalitaire, le crime serait-il moins grave ? La démocratie parlementaire est au moins aussi guerrière et conflictuelle que ceux auxquels elle s'en prend. Je le répète, en politique, on a des ennemis et, quand on n'en a pas, on les invente. C'est aussi vrai des démocraties que des défunts Etats socialistes. La vérité est qu'il faudra en finir avec l'Etat, quelle qu'en soit la forme.
La démocratie est aussi le régime où vous avez pu mener, de la Rue d'Ulm, une attaque au vitriol contre l'un des deux principaux candidats à la présidence de la République... Cet argument n'est pas entièrement convaincant. Que le système des libertés soit plus déployé dans les sociétés protégées est indéniable. Mais c'est parce qu'elles en ont les moyens économiques et ferment leurs frontières aux hommes, et non aux marchandises ou aux capitaux, pour conserver ce privilège. La question qui m'intéresse est tout autre : peut-on soutenir, nommer, faire exister quelque chose qui relève d'une autre hypothèse stratégique que celle de la continuation de l'univers réglé par le profit qui régente les sociétés dominantes ? Bien entendu, il faut intégrer le bilan des tentatives précédentes. On ne va pas rééditer ce qui a été fait au XXe siècle.
Bonne nouvelle... Je n'aboierai cependant pas avec les loups. C'était la première fois dans l'Histoire que les gens d'en bas prenaient le pouvoir. Comment peut-on avoir le front d'exiger qu'ils réussissent du premier coup ? Le pouvoir des riches, lui, est millénaire ! La Révolution, telle qu'elle a existé au XXe siècle, est une figure aujourd'hui morte. Faut-il pour autant devenir un honorable réformiste-libéral ? Je n'ai pas envie de faire entrer la philosophie dans le cadre de ce conservatisme. C'est l'unique raison pour laquelle je ressors du ruisseau où il est tombé le signifiant « communisme ».
Adversaire déterminé du pouvoir, vous exercez un pouvoir considérable, notamment auprès de ce que votre ex-compagnon Jean-Claude Milner appelle la « petite-bourgeoisie intellectuelle ». Normalien, vous enseigniez à Normale, d'où sortent vos disciples. Gauchet remarquait ici-même que vous êtes un produit très français. J'assume ce paradoxe, si c'en est un. Dans l'un de mes premiers livres, j'écrivais : « J'aime mon pays, la France. » Comme je vous l'ai dit, toute universalité se fabrique à partir de singularités. Et les singularités françaises ont leur généalogie propre. Au XVIIIe siècle, les « philosophes » constituaient quasi un parti politique. On peut jouer sur deux tableaux, être à la fois un homme public et un savant. Quant au pouvoir... Franchement, comment un philosophe peut-il servir la part du peuple la plus démunie s'il ne la fait pas bénéficier, directement et indirectement, de son aura, des lambeaux de pouvoir que son oeuvre lui permet d'arracher ? Ce pouvoir n'est au fond que celui de l'Idée. Je combattrai jusqu'au bout la misérable maxime du monde contemporain, cachée sous le manteau de la fameuse mort des idéologies : « Vis sans Idée. » La vraie vie est la vie habitée par l'Idée. En amour comme en politique
1937 : Naissance à Rabat (Maroc). 1956 : Ecole normale supérieure. 1960 : Agrégation de philosophie. 1962-1967 : Enseigne la philosophie à Reims. « Almagestes » et « Portulans » (romans, Seuil). 1968-1999 : Enseigne à Paris-VIII. Militant de l'Union des communistes de France marxistes-léninistes, puis de l'Organisation politique. 1982 : « Théorie du sujet » (Seuil). 1988 : « L'être et l'événement » (Seuil). 1993 : « L'éthique » (Nous). 1997 : « Calme bloc ici-bas » (roman, POL). 1999-2009 : Professeur, puis professeur émérite à l'ENS. 2005 : « Le siècle » (Seuil). 2006 : « Logiques des mondes » (Seuil). 2007 : « De quoi Sarkozy est-il le nom ? » (Lignes). 2009 : « L'hypothèse communiste » (Lignes).
« Eloge de l'amour », Alain Badiou avec Nicolas Truong (Flammarion, « Café Voltaire », 90 pages, 12 euros).© 2009 Le Point. Tous droits réservés.

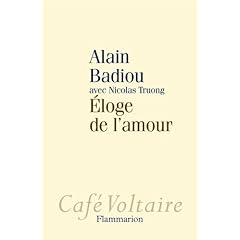




0 commentaires:
Enregistrer un commentaire