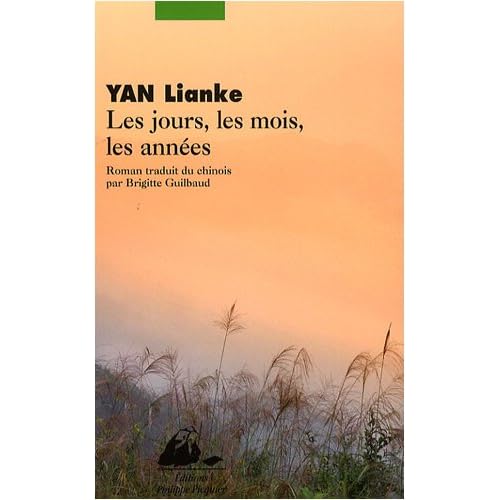Courrier international, no. 956
Courrier international, no. 956DÉVELOPPEMENT CAPITALISTE ET DICTATURE
Le très faible niveau des salaires ne suffit pas à expliquer l'expansion économique de ces dernières décennies. L'historien chinois Qin Hui estime que l'absence de droits sociaux a été un facteur plus déterminant.
Le monde des économistes internationaux a une approche assez disparate de la Chine, mais on peut distinguer trois grandes tendances. Il y a tout d'abord les tenants de la "théorie de l'effondrement", qui considèrent que la forte croissance économique chinoise n'est qu'une illusion faite d'exagérations et que, en réalité, la crise intérieure et la mondialisation exercent des pressions de plus en plus fortes qui entraîneront inévitablement un effondrement. Les deux autres tendances s'accordent à penser tout le contraire, à savoir que l'économie chinoise peut effectivement se targuer d'une croissance et d'une prospérité miraculeuses. Mais elles donnent deux interprétations distinctes et opposées, selon que leurs tenants appartiennent à l'un ou à l'autre des grands courants de la pensée économique occidentale : l'approche libérale classique impute le "miracle chinois" à la libéralisation économique et à l'ouverture aux règles du marché, tandis que les économistes de gauche ou keynésiens l'attribuent aux réussites du "socialisme", à l'intervention et à la mainmise de l'Etat sur l'économie.
Je considère pour ma part que ces trois approches comportent chacune de graves erreurs : il est un fait que l'économie chinoise a connu une croissance forte et soutenue et s'est insérée avec facilité dans la mondialisation ; aussi ne peut-on que réfuter les théories de "l'illusion" et de "l'effondrement". Cependant, cette croissance ne peut s'expliquer ni comme une "réussite de l'Etat", ni comme une "réussite du marché", et encore moins comme une "double réussite du marché et de l'Etat", connue sous le nom de "consensus de Pékin" [parfois érigé en modèle de développement]. Outre les avantages que lui procurent traditionnellement des salaires et une protection sociale faibles, la Chine a surtout tiré parti de son peu de respect des droits de l'homme pour maintenir artificiellement bas les prix de quatre grands facteurs (la main-d'oeuvre, la terre, le capital et les ressources naturelles non renouvelables). En interdisant toute possibilité de marchandage, pour "abaisser le coût des transactions", elle a restreint, voire supprimé totalement le droit de négociation des plus faibles. En refusant la démocratie, en réfrénant les envies de participation, en méprisant la pensée, en dédaignant les croyances, en faisant peu de cas de la justice et en aiguisant les appétits matériels, elle a incité les gens à concentrer leur énergie sur la simple quête de l'enrichissement "miracle". Tout cela lui a permis de dégager une étonnante compétitivité, rarement observée aussi bien dans les pays à économie libérale que dans les "Etats-providence", et de distancer les pays engagés sur les rails de la démocratie de façon progressive ou selon le principe de la "thérapie de choc" [les anciens pays socialistes de l'Europe de l'Est].
Aujourd'hui, chacune des parties cherche à prouver la justesse de sa théorie en s'appuyant sur le "succès de la Chine". Tandis que c'est le caractère non libéral de l'économie chinoise qui fait l'admiration du clan de gauche, le clan de droite s'extasie devant son caractère non social. Par ailleurs, la Chine fait des envieux dans le tiers-monde en raison de son image de pays pauvre se développant à toute vitesse. Aussi la Chine, qui se pose en sérieux challenger des pays développés et des pays en développement, des Etats-providence comme des Etats libéraux, de la gauche comme de la droite, suscite-t-elle l'admiration de tous.
Mais pour combien de temps encore ? Les avantages de la Chine ne sont pas reproductibles : sans la poigne de fer à la chinoise, aucun pays, qu'il soit dirigé par un gouvernement de gauche ou de droite, qu'il applique une politique libérale de marché, une politique keynésienne ou même une politique sociale-démocrate, n'est en mesure de parvenir à une telle accumulation primitive*. Le "défi" posé par la Chine aux autres pays existe objectivement et devrait même s'aggraver inexorablement. Les relations avec la Chine peuvent-elles donc être envisagées avec optimisme sur le long terme ?
En fait, en ces temps de mondialisation, les "chocs" qui se produisent entre les méthodes de la Chine et celles de l'Occident, voire du reste du monde, sont de plus en plus révélateurs d'un problème de fond.
L'arrivée de très nombreuses entreprises étrangères en Chine a poussé les salariés à faire des comparaisons. Beaucoup de Chinois soulignent qu'en matière de respect des droits des travailleurs en Chine les entreprises européennes et américaines offrent les meilleures conditions, tandis que la situation est plutôt médiocre dans les sociétés japonaises ou sud-coréennes, mauvaise dans les entreprises hongkongaises et taïwanaises, les pires conditions étant celles des entreprises chinoises, privées ou publiques !
Beaucoup d'investisseurs européens et américains sont accourus en Chine pour contourner la législation du travail de leur propre pays. Mais leur longue "tradition sociale" d'Etat-providence démocratique a fait qu'ils ont souvent eu du mal à s'y accoutumer : ils n'avaient pas "l'habitude" de traiter si mal les travailleurs. A tel point que des officiels chinois sont parfois intervenus pour mettre le holà à des accords sociaux déjà conclus entre des entreprises étrangères et leurs salariés. Cependant, avec le temps, certains chefs d'entreprise européens et nord-américains ont fini par se plier aux coutumes locales et par apprendre à mater les travailleurs ou à se concilier les bonnes grâces de l'administration...
A l'inverse, lorsque des entreprises chinoises vont s'implanter à l'étranger, le premier obstacle auquel elles se heurtent est celui des organisations syndicales ouvrières et paysannes. C'est le cas, il va sans dire, en Europe et en Amérique du Nord, mais l'Amérique latine, considérée chez nous comme un exemple typique de "néolibéralisme", semblait être un paradis pour le capitalisme, avec des ouvriers très brimés. Pourtant, quand les entreprises chinoises ont pris pied là-bas, elles se sont tout de suite aperçues du contraire : là-bas, c'était le prolétariat qui "brimait" le capital ! Ainsi, la plus grosse société chinoise implantée en Amérique latine, Shougang Hierro Perú [premier producteur de fer au Pérou, acquis par la société chinoise Shougang en 1992], a "violé la loi" (le Code du travail local) en réprimant une manifestation d'ouvriers et en licenciant des syndicalistes en grève [les conflits à propos des conditions de travail et des salaires y sont récurrents]. Finalement, le "héros des ouvriers péruviens", Juan de Dios Ramírez Canchari, est devenu parlementaire, puis ministre du Travail du Pérou, et sa fille a été démocratiquement élue maire de la ville où était implantée Shougang Hierro. [Edith Ramírez Rodríguez a été maire de San Juan de Marcona de 2003 à 2006.] La société a depuis sans cesse été "importunée" par des mouvements ouvriers, d'où de graves pertes financières. Les médias chinois ont à cette occasion lancé une mise en garde : "Attention au piège des syndicats quand on investit à l'étranger !" Nos patrons ont ainsi appris à leurs dépens ce que signifiait la phrase : "Ouvriers, nous sommes forts !" [chant datant du début de la république populaire de Chine].
Les travailleurs les plus dociles du monde
Comme il ne fait pas bon irriter les ouvriers latino-américains, nos entreprises ont jeté leur dévolu sur l'Afrique, où la population est pauvre, les salaires bas et les gouvernements moins avancés qu'en Amérique latine. En de nombreux endroits règnent encore des dictateurs et, contrairement à l'Amérique latine, ils n'ont répondu ni aux sirènes du "socialisme à l'occidentale", ni à celles de la "social-démocratie". Loin de nous ingérer dans leurs affaires intérieures, nous nous y sentons au contraire comme un poisson dans l'eau. Nos entrepreneurs chinois qui ont appris en Chine à s'attirer les faveurs des membres de l'administration ont l'occasion d'y déployer tous leurs talents, et les chefs d'entreprise occidentaux ne leur arrivent pas à la cheville.
Les entreprises chinoises se sont cependant très vite rendu compte que tout n'était pas comme chez elles. Bien que les ouvriers ne soient pas aussi virulents que leurs homologues européens, nord-américains et même latino-américains, ces anciennes colonies ont quand même contracté de "mauvaises habitudes" auprès de l'Occident. Tout d'abord, le degré de liberté des médias est malgré tout plus élevé qu'en Chine. La démocratie n'a pas réussi à prospérer, mais il existe quand même une opposition et une certaine concurrence entre les candidats qui cherchent à rallier les suffrages des travailleurs. Les syndicats peuvent certes difficilement afficher des opinions contraires au gouvernement, mais ils ont quand même une influence importante en matière de droits des travailleurs. De plus, ces dernières années, de nouveaux soucis sont venus de l'arrivée d'ONG occidentales soucieuses de protéger l'environnement ou les droits des populations autochtones. Mais beaucoup d'entreprises chinoises ont vite découvert un bon filon : celui des travailleurs transfrontaliers originaires de pays pauvres de l'intérieur du continent africain, nombreux à se rendre dans les pays côtiers, plus riches. Ces émigrés clandestins ne sont pas protégés par les codes du travail locaux ni par des syndicats. Ils ont donc été embauchés massivement par les entreprises chinoises implantées en Afrique. Mais celles-ci ont découvert peu après que la plupart de ces ouvriers transfrontaliers travaillaient en fait dans la région de leur propre tribu et que, s'ils n'étaient pas sous la protection de lois nationales et de syndicats modernes, ils pouvaient compter sur l'appui de leur tribu en cas de conflit avec leur patron.
Les entreprises chinoises ont finalement dû se rendre à l'évidence : les travailleurs les plus dociles au monde étaient encore les travailleurs chinois ! Les ouvriers chinois d'origine rurale sont habitués à un faible respect des droits de l'homme. De plus, une fois arrivés en Afrique, ils sont coupés de leur famille, confrontés à la barrière de la langue et n'ont plus aucun lien social sur lequel compter. Il n'y a vraiment pas à redouter leur insoumission quand ils sont enfermés dans les baraques de chantier ! C'est pourquoi de nombreuses entreprises chinoises implantées en Afrique ont finalement fait le choix de recourir aux ressources naturelles locales et d'écouler sur place leurs produits, mais, pour ce qui est de la main-d'oeuvre, elles se sont débrouillées pour la faire venir en masse de Chine, quitte à prendre au passage des libertés avec les lois locales...
Aussi, dans un contexte de mondialisation croissante des marchés - sans que cela s'accompagne d'une mondialisation de la protection des droits de l'homme -, le "facteur Chine" est un élément qui pose un défi de plus en plus sérieux à l'échelle planétaire aux droits des travailleurs et au modèle social de l'Etat-providence.
La délocalisation de la production industrielle vers la Chine, avec la réduction des effectifs et les fermetures d'usines accordant une forte protection sociale, est un phénomène qui touche toutes les industries aux Etats-Unis et en Europe. Cette tendance n'est pas nouvelle, mais elle est généralement considérée comme une simple mutation industrielle, les industries à forte densité de main-d'oeuvre des pays développés aux coûts salariaux importants transférant leurs activités vers les pays en développement pratiquant des salaires bas. Cette mutation existe bel et bien, et d'ailleurs ce n'est pas une mauvaise chose en soi - ou plutôt ce devrait être une bonne chose.
Cependant, le fait qu'une entreprise comme General Motors réalise de gros bénéfices en Chine alors qu'elle ne parvient pas à gagner de l'argent dans un pays comme l'Inde, qui comme la Chine pratique des salaires bas mais où les syndicats sont puissants, le fait que les constructeurs automobiles chinois qui s'implantent à l'étranger soient pris au "piège des syndicats", au point que même le groupe indien Tata envisage de délocaliser sa production automobile en Chine [il possède déjà une usine de composants automobiles à Nankin et également plusieurs sous-traitants], où les salaires sont légèrement plus élevés mais où les syndicats n'existent pas, tout cela montre bien que la refonte planétaire en cours ne se résume pas seulement à un transfert de la production des régions à hauts salaires vers les régions à bas salaires - on peut même dire qu'il ne s'agit pas d'un transfert de cette nature -, mais consiste surtout en un transfert de la production des régions très respectueuses des droits de l'homme vers les régions peu respectueuses des droits de l'homme. Cela correspond certes à une mutation économique, mais surtout à la prise en compte des avantages et des défauts de tel ou tel régime. Cela ne signifie pas, comme le prétendait Francis Fukuyama, la victoire de la démocratie libérale et la fin de l'Histoire, mais plus probablement l'échec de deux cents ans de mouvements sociaux et d'idéaux socialistes, de cent ans de systèmes démocratiques de protection sociale et d'un millier d'années d'aspiration à l'égalité entre les hommes. L'optimisme n'est donc pas de mise dans les rangs des libéraux, ni dans ceux des socialistes (non staliniens).
N'oublions pas que le "changement de modèle économique" a un long passé dans l'histoire moderne ! Mais celui d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Tout d'abord, jadis, si la délocalisation de l'industrie manufacturière traditionnelle affaiblissait probablement les syndicats traditionnels des pays développés, elle apportait malgré tout la "culture sociale industrielle" dans les pays de transfert de la production. Cela avait permis l'émergence de syndicats ouvriers et paysans, et des progrès importants en matière de droits des travailleurs, de démocratie sociale et d'un système public de protection sociale en Amérique latine, en Asie de l'Est et en Inde. Bien que, dans les années 1980, la notion d'Etat-providence eût commencé à achopper sur des difficultés dans les pays développés, la social-démocratie continuait à progresser sur l'ensemble du globe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La protection sociale est en difficulté dans les pays qui délocalisent ; quant à la Chine, où viennent s'implanter ces industries, elle n'a pas du tout été réceptive à cette "culture sociale" : les syndicats [autonomes] ouvriers et paysans y sont toujours interdits, les ateliers de misère ("sweatshops") y sont encore monnaie courante et l'accumulation primitive se fait encore au prix du faible respect des droits de l'homme. Cela montre bien que la social-démocratie se trouve au creux de la vague au niveau planétaire.
Un essor basé sur le non-respect des droits de l'homme
A l'évidence, le changement de structure industrielle ne suffit pas à expliquer les difficultés du système démocratique de protection sociale et des syndicats. Les véritables raisons sont à rechercher dans l'avantage que constitue pour certains pays leur manque de respect des droits de l'homme et qui pousse les autres à s'aligner sur eux bon gré mal gré.
En fait, aujourd'hui, imperceptiblement, le débat sur ce qui fait la "supériorité chinoise" évolue. Prenons la comparaison entre la Chine et l'Inde, dont les Chinois aiment tant parler. A l'époque de Mao Tsé-toung, tous les Chinois pensaient dur comme fer que la Chine tirait sa supériorité du socialisme, tandis que l'Inde était désavantagée par son attachement au capitalisme. A l'époque des réformes, ils ont ensuite imputé le retard de l'Inde à la persistance de son modèle d'économie planifiée à la soviétique. Dernièrement, davantage de Chinois commencent à insister sur le fait que l'Inde est handicapée par l'influence trop forte de facteurs comme les droits des travailleurs, la protection sociale ou les syndicats. Autrement dit, "l'échec" de l'Inde (comparativement à la Chine) est maintenant dû non pas au capitalisme, ni au régime de type soviétique, mais à la démocratie sociale.
Les critiques de type stalinien de l'Inde et de l'Europe de l'Est ont repris de la vigueur, accusant notamment ces régions d'être tombées dans la démocratie libérale et le capitalisme. Nous voyons ici une autre facette de la Chine L'Europe de l'Est et l'Inde sont critiquées par la gauche pour les libertés accordées à leurs populations et par la droite pour les avantages sociaux et la protection des droits ouvriers et paysans. [Dans un rapport de 2008 de la Banque asiatique de développement, classant les pays asiatiques d'après leur niveau de protection sociale, l'Inde était mieux classée que la Chine.] Les deux critiques semblent fonder leurs arguments sur une base commune, à savoir que la forte croissance économique de la Chine est réalisée grâce à l'avantage que lui procure son faible respect des droits de l'homme sous un régime ni libéral ni social.
Mais notre modèle de développement recèle des dangers non négligeables. Tout en posant un sérieux défi aux Etats-providence démocratiques étrangers, à l'intérieur du pays, ce modèle produit l'effet d'une chenille arpenteuse : que l'on penche "à gauche", et les libertés sont amoindries sans que la protection sociale s'améliore pour autant, que l'on penche "à droite", et la protection sociale est réduite à néant sans que progressent forcément les libertés. Dans le premier cas, les libertés individuelles sont réduites sans que soit donné libre cours pour autant à la participation publique ; dans le second cas, la participation démocratique est réprimée et la libre concurrence est limitée. La "gauche" ne parvient pas à édifier un Etat-providence ; la "droite" ne réussit pas à mettre en place un marché libéral équitable. Comme l'a dit le sociologue Sun Liping, ceux qui bénéficient des politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, ce sont toujours les mêmes, les plus puissants, et ceux qui en pâtissent, ce sont toujours les plus démunis. C'est ainsi que la société, dans son avancée faite d'expansions et de contractions comme la marche d'une chenille arpenteuse, connaît des tensions de plus en plus étendues et nombreuses, et ne parvient pas à maintenir un certain équilibre comme sous un régime démocratique constitutionnel.
Par conséquent, dans le cas du boom chinois, on ne peut résoudre le problème du mauvais partage du gâteau en faisant un gâteau plus gros, comme certains l'envisagent, car le développement économique s'accompagne d'une aggravation simultanée des tensions à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous avons assis notre légitimité sur notre croissance économique et nous avons dit que si nous ne nous étions pas effondrés, contrairement à l'Europe de l'Est, c'était grâce aux performances de notre économie. Or, aujourd'hui, cette interprétation est de plus en plus remise en cause avec la montée de l'instabilité sociale qui accompagne la forte croissance. C'est pour cela que le gouvernement de Hu Jintao et Wen Jiabao prône l'harmonie et insiste plus qu'auparavant sur les notions d'équité et de mission de service public, une tendance qu'il convient de saluer. Cependant, si l'effet de la chenille arpenteuse reste inchangé, il est à craindre que le pouvoir ne renforce encore son emprise, sans pour autant assumer ses responsabilités. Sous le régime actuel, rétablir un gouvernement fort ne pourrait qu'enclencher un nouveau cercle vicieux où l'élargissement des pouvoirs fait qu'il se soustrairait toujours à ses responsabilités. Or, pour sortir de l'effet de la chenille arpenteuse, il faut engager des réformes constitutionnelles visant à une adéquation entre le pouvoir et ses obligations.
Si un pays aussi grand et aussi peuplé que la Chine était en difficulté, le choc risquerait d'être plus fort encore que le krach boursier de 1929 aux Etats-Unis. Aussi faut-il souhaiter que la Chine réussisse en douceur sa transition, car ce n'est pas seulement son bonheur qui en dépend, mais celui du monde entier. Inversement, si jamais la Chine connaissait une explosion sociale à cause de l'effet de la chenille arpenteuse ou bien si le conflit entre le mode actuel d'accumulation primitive et les Etats-providence, d'une part, ainsi que les pays libéraux, d'autre part, entraînait l'effondrement de l'ordre mondial, ce ne serait pas seulement la Chine qui serait plongée dans le malheur, mais le monde entier...
* Notion marxiste désignant le processus par lequel les capitalistes accumulent de l'argent avant de s'engager dans le développement de l'industrie.
Qin Hui
Lingdaozhe (Hong Kong, Pékin)
© 2009 Courrier international. Tous droits réservés.
 Le Monde - International, samedi, 28 février 2009, p. 5
Le Monde - International, samedi, 28 février 2009, p. 5